Prérequis
- Prise de notes
- Méthode de la dissertation d’histoire
- Méthode du commentaire de document historique
- Repères chronologiques sur l’histoire de la Grèce du Ve siècle (cf. cours du S1 et S2)
Objectifs
Ce cours offre une ouverture sur l’histoire politique de la Grèce antique au IVe siècle. C’est une période de profondes mutations du monde grec qui voit la fin du monde bipolaire constitué au Ve siècle par l’opposition idéologique et militaire d’Athènes et de Sparte. Il en ressort des luttes féroces entre cités, confédérations et royaumes pour établir leur hégémonie sur la Grèce, y compris de la part de puissances auparavant mineures au Ve siècle, comme Thèbes, la Thessalie ou la Macédoine, et qui connaissent un essor remarquable au IVe siècle.
Assez bien documenté par les sources littéraires (l’œuvre de Xénophon par exemple) et par les sources épigraphiques (les inscriptions, nombreuses à Athènes), le IVe siècle présente comme particularité d’être marqué certes par des conflits, mais aussi par des pratiques diplomatiques nouvelles aboutissant à des constructions politiques originales (« les paix communes ») mais aussi à une reconfiguration des relations entre puissances avec notamment une irruption du Grand Roi perse dans le jeu politique grec.
Le cours commence en 404 avec la défaite d’Athènes dans la guerre du Péloponnèse et se termine en 301 avec la fin des guerres entre les successeurs d’Alexandre. Il a donc comme particularité de dépasser les découpages chronologiques conventionnels entre « époque classique » et « époque hellénistique », pour mieux voir comment l’émergence de la puissance macédonienne puis l’aventure militaire et politique d’Alexandre le Grand ont contribué à redessiner un monde grec plus vaste, multiculturel, ouvert sur l’Asie, et dans lequel les anciennes cités grecques devaient désormais coexister avec des royaumes macédoniens construits par les successeurs d’Alexandre (les Diadoques) sur des modèles politiques hybrides.
Contenu
- Chap 1 : Pourquoi Athènes a-telle perdu la guerre du Péloponnèse (404) ?
- Chap 2 : Comment le Grand Roi des Perses est-il devenu le maître du jeu diplomatique en Grèce ? (400-386)
- Chap 3 : Comment Athènes est-elle redevenue une puissance ? (386-377)
- Chap 4 : Comment Thèbes a-telle ravi l’hégémonie à Sparte ? (375-362)
- Chap 5 : Athènes a-t-elle reproduit les erreurs du passé dans sa 2e Ligue Maritime ? (années 360)
- Chap 6 : Comment Philippe de Macédoine a-t-il profité d’un monde multipolaire en crise ? (350-336)
- Chap 7 : En quoi la guerre d’Alexandre contre les Perses est-elle une guerre panhellénique ? (336-
- Chap 8 : En quoi Alexandre a-t-il cherché à s’approprier le monde achéménide et ses structures ?
- Chap 9 : Quelles ont été les forces et les faiblesses de l’empire gréco-perse d’Alexandre ?
- Chap 10 : Quel nouvel ordre politique émerge du chaos des guerres entre les successeurs d’Alexandre ?
Références bibliographiques
Outils
- Laurianne Martinez-Sève et Nicolas Richer, Grand Atlas de l’Antiquité grecque classique et hellénistique, Paris, 2019, éditions Autrement (l’atlas de référence en langue française, il existait avant en deux volumes séparés : classique / hellénistique)
Sur les relations entre le monde grec et l’empire achéménide (404-334)
- Pierre Briant, Histoire de l’empire perse. De Cyrus à Alexandre, Paris, Fayard, 1996, surtout p. 631-836 [la « Bible » sur l’empire perse, ouvrage très riche avec lequel il faut vous familiariser et dans lequel il faut aussi savoir naviguer grâce à l’index final]
- Pierre Carlier, Le IVe siècle grec. Jusqu’à la mort d’Alexandre, Paris, Éditions du Seuil, 1995 [manuel centré sur la Grèce d’Europe et qui fournit, de manière synthétique, la trame événementielle]
- Catherine Grandjean (dir.), La Grèce classique. De Clisthène à Aristote. 510-336, Paris, Belin, 2022 [manuel le plus récent sur cette période, bien illustré et pédagogique]
Sur Alexandre le Grand (336-323)
- Pierre Briant, Alexandre le Grand, Paris, PUF, Collection « Que sais-je ? », 2019, 9e édition mise à jour, désormais aussi accessible online sur le site de la BU [ouvrage très synthétique (125 p.) qui fournit non seulement la trame événementielle de la conquête de l’empire achéménide par Alexandre mais surtout les débats et perspectives historiographiques animés par Pierre Briant depuis les années 1980. On retrouve aussi ces réflexions et conclusions, mais du point de vue perse, dans Briant, Histoire de l’empire perse, p. 837-892]
- Nicholas Hammond, Le génie d’Alexandre, Paris, Economica, 2002 (trad. française d’un ouvrage de 1997) [récit facile à lire de la campagne d’Alexandre, sans notes de bas de page mais nourri par les réflexions de toute une vie et l’érudition d’un très grand spécialiste d’Alexandre et de la Macédoine antique]
Sur le monde hellénistique (à partir de 323)
- Edouard Will, Histoire politique du monde hellénistique, Paris, Points Seuil, t. 1 1979, t. 2 1982 [une somme, qu’il n’est pas question de lire en entier, mais qui n’a pas été égalée et permet une très bonne compréhension des aspects événementiels. Très bien écrit et très agréable à lire].
- Andrew Erskine (dir.), Le monde hellénistique. Espaces, sociétés, cultures. 323-31 av. J.-C., Rennes, PUR, 2004 [ouvrage collectif volumineux constitué de nombreux articles synthétiques présentant les aspects essentiels du monde hellénistique]
- Catherine Grandjean, Geneviève Hoffmann et al., Le monde hellénistique, Paris, Armand Colin, 2008 [un manuel synthétique sur le monde hellénistique, un peu « compact » mais très utile]
- Philippe Clancier, Omar Coloru, Gilles Gorre (dir.), Les mondes hellénistiques. Du Nil à l’Indus, Paris, Hachette Supérieur, 2017 [manuel écrit selon des perspectives historiographiques récentes, à savoir intégrer l’histoire des communautés locales de l’Orient et de leurs relations avec les pouvoirs centraux grecs, en exploitant aussi les sources que ces communautés ont produites]
Modalités de contrôle des connaissances et des compétences
- Contrôle continu (en TD)
- Examen terminal écrit (4h) : Dissertation ou commentaire de document historique (au choix)
- (Idem en session 2)
En savoir plus
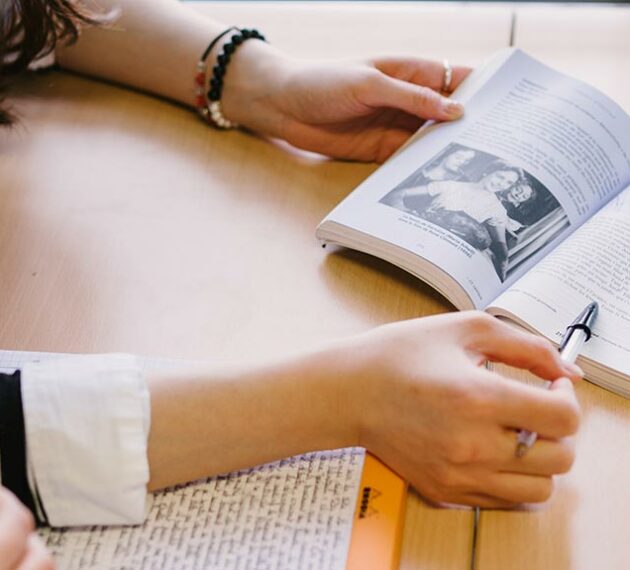
Retrouvez tous les détails des cours des formations de la Faculté des Lettres et Civilisations en ligne.

La Licence d’Histoire propose deux parcours en géopolitique et géographie.

La Faculté propose une licence de Lettres modernes,une licence d’Histoire, une prépa IEP et un Bachelor Développement Touristique.