Prérequis
- Autonomie dans la recherche d’information et la lecture d’ouvrages historiques spécialisés.
- Mise en oeuvre des acquis de Terminale (HGGSP, thème « Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution »).
Objectifs
Ce cours propose une étude générale de la période moderne à travers une thématique large : l’étude des relations internationales et la naissance de la diplomatie moderne.
Il s’agit, dans une démarche comparatiste de travailler aux différentes échelles spatiales — du local au mondial — et, pour les étudiants, de se doter d’une culture générale de géographie historique.
Le cours permet de travailler les compétences rédactionnelles transversales selon les règles de la discipline.
Contenu
Les relations internationales ne sont pas un donné immuable. Pour discuter, négocier, définir des relations entre puissances, encore faut-il que les interlocuteurs partagent une grammaire politique commune. Cette pratique des relations internationales encadrant le fonctionnement des États se complexifie à l’époque moderne. Des enjeux religieux nouveaux ainsi qu’un un premier phénomène de mondialisation reliant États européens, possessions coloniales et puissances impériales constituent un changement majeur dans les conceptions diplomatiques.
Les États se structurent en parallèle de ce nouvel ordre international : les négociations ne sont plus seulement le fait de princes, mais sont organisées entre États qui s’appuient sur des savoir-faire et des pratiques spécifiques. On sera tout particulièrement attentif aux conditions concrètes de ces relations diplomatiques : le rôle des ambassadeurs, des consuls mais aussi des pratiques de la diplomatie (lettre de créance, salutations, remise des présents…).
En parallèle de la naissance d’une diplomatie moderne à l’échelle du continent européen, on étudiera la manière dont celle-ci s’inscrit dans le fonctionnement d’autres acteurs étatiques à l’échelle mondiale, dans une perspective d’histoire connectée. Les empires safavide, moghol, ottoman, seront ainsi autant de points de comparaison des dispositifs mis en place pour assurer le bon fonctionnement des négociations internationales.
Ces phénomènes seront étudiés sur un temps long : de la fin du XVe siècle (la « société des princes » en Europe) jusqu’au début du XIXe siècle.
Références bibliographiques
- ARANDA Olivier, GUINAND Julien, LE MAO Caroline, Atlas des guerres à l’époque moderne (XVIe-XVIIe-XVIIIe siècle), Paris, Autrement, 2023.
- BERTRAND Romain, L’Histoire à parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occident, XVIe-XVIIe siècle, Paris, Seuil, 2011.
- BROOK Timothy, Le Chapeau de Vermeer : le XVIIe siècle à l’aube de la mondialisation, Paris, Payot, 2012 (rééd.).
- DRÉVILLON Hervé (dir.), Mondes en guerre. Tome 2 : « L’âge classique XVe-XIXe siècle», Paris, Passé Composé, 2019.
- GRATALOUP Christian (dir.), Atlas historique mondial, Paris, Les Arènes, 2019 (rééd.).
- HÉLIÉ Jérôme, Les Relations internationales dans l’Europe moderne. 1453-1789, Paris, Armand Colin, « Collection Y », Paris, 2019 (réed.).
- HUGON Alain, Rivalités européennes et hégémonie mondiale : modèles politiques, conflits militaires et négociations diplomatiques, XVIe-XVIIe siècle, Paris, Armand Colin (coll. « Cursus »), 2002.
Modalités de contrôle des connaissances et des compétences
- Epreuve écrite de mi-semestre : dissertation (3h).
- Terminal écrit : dissertation ou commentaire de document(s) au choix sur table (3h).
En savoir plus
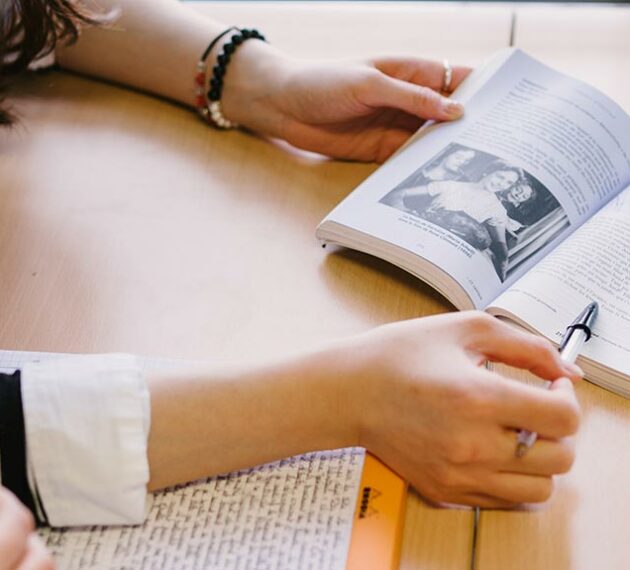
Retrouvez tous les détails des cours des formations de la Faculté des Lettres et Civilisations en ligne.

La Licence d’Histoire propose deux parcours en géopolitique et géographie.

La Faculté propose une licence de Lettres modernes,une licence d’Histoire, une prépa IEP et un Bachelor Développement Touristique.